Parce qu’il y a trois mois de films à rattraper, autant de vieilles notes à publier, et qu’on a réussi l’exploit d’être moins rapide que les Césars. Let’s go !
Fatima
Philippe Faucon / 2015
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, elle travaille comme femme de ménage.
Quelques spoilers. Le cinéma de Faucon a ceci de commun avec celui d’Ocelot que le spectateur y hésite entre deux manières de recevoir les choses : Fatima est-il une simple entreprise didactique, où tout est fait pour détourer un propos ? Ou bien se joue-t-il là un désir plus mystérieux de ligne claire, un profond plaisir à la limpide articulation du monde ? Un détail anodin incarne cette ambivalence : la façon de filmer les transports en commun. Calmes, propres, neufs et pacifiés, ils participent en un sens à cet éloge sage de la république : ses représentants (par exemple les médecins) sont souvent des alliés, et en opposant à la jeune héroïne de multiples perdants, tous milieux sociaux-culturels confondus, le film se clôt en chantant la méritocratie. Mais ces bus et trains lumineux sont aussi un moyen de déblayer l’inutile, d’évacuer l’imagerie urbaine qu’on associe trop souvent aux enfants de l’immigration. Retour, en somme, à l’essentiel : le film fait comme table rase de la sociologie préalable à son sujet (le récit est par exemple expurgé de toute dimension religieuse) pour nous raconter à nouveau, « du début », sa très simple histoire sur des bases assainies – celles, tout simplement, de ses personnages. Il plane certes sur ce projet économe le risque d’une épure austère, mais la présence solaire d’une jeune actrice extraordinaire permet à l’ensemble de s’incarner : le film théorique gagne alors un pouls, une claire respiration, la santé d’un élan vital.
Carol
Todd Haynes / 2016
Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d’un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d’une cliente distinguée, Carol, femme séduisante prisonnière d’un mariage peu heureux.
Quelques spoilers. Contre la sophistication glacée nimbant les années 50, pour qui les aborde sous le patronage de Sirk, Todd Haynes répond un étonnant New York charbonneux, monde embué de vitres encrassées où les motifs d’égouts font dentelle, et où la pauvreté envahit jusqu’aux grands magasins trop vides. Le glamour n’est même plus ici cette coquille vide, ce néant qu’on devinerait à mi-mots derrière les impeccables parures : sa corruption se lit désormais sur la surface du monde, qui semble tout entier frappé d’une discrète lèpre. Et pourtant, jusqu’au grain rêche du 16mm, cette image sale est aussi une chaleur, un écrin à l’intimité douloureuse de personnages blottis comme dans du feutre, contre la laideur de l’hiver dehors. Un paradoxe déchire cette unité, et c’est Carol elle-même : rien de brûlant ne semble remuer sous la glace du personnage (au contraire, là encore, de tant d’héroïnes Sirkiennes). L’icône Blanchett est lâchée dans le film comme un corps étranger de froide perfection : sa maîtrise continuelle, son ascendant d’expérience, ses manières reptiliennes, dessinent alors moins une romance émue qui transcenderait les différences (d’âge, de classe), qu’un rapport de séduction qui les souligne d’autant plus – le film se retrouvant alors, sans le vouloir, à broder une imagerie saphique de dévergondage… Il faut attendre que Carol se retrouve dos au mur pour que les personnages se rejoignent dans un rapport de clandestinité égal (l’une contre ses pudeurs, l’autre contre son milieu). D’où un film décontenançant, dont les paradoxes parasitent parfois l’identification, et dont on ne sait toujours s’il veut ces aléas complexes (dont la fin, réjouissante, vient encore redoubler les surprises), où s’ils sont un accident.
Children of Eve
John H. Collins / 1915
L’étudiant Henry Madison tombe amoureux d’une femme déchue, qui le quitte de peur de compromettre sa carrière. Réfugiée dans les quartiers pauvres de la ville, elle donne naissance à leur fille et meurt peu après, laissant celle-ci orpheline.
Il faut se replonger dans ces films américains lambdas de 1915, pour se rappeler que le pays protestant d’alors n’avait rien à envier aux théocraties redoutées d’aujourd’hui… Le puritanisme moralisateur du mélodrame muet, qui nous arrive habituellement réfracté par milles ambiguïtés chez les grands noms du genre, nous apparaît ici dans toute sa littéralité (d’autant plus dans ces productions « à message » qui marquèrent la fin des Studios Edison). Children of Eve hérite ainsi d’une narration hautement ellipsée, chaque scène se déduisant de la précédente comme par démonstration, pour se clore dès son propos transmis : l’essence didactique du projet, très vite, lui donne le rythme d’un livre d’images. Au-delà du plaisir déviant à éprouver le parfait confort de ce manichéisme, que sert une mise en scène économe (l’évidente pauvreté de la production, ici, aide à conférer au film une certaine unité), Collins sait parfois quitter l’équilibre de ses tableaux pour de puissants emballements (la déclaration fiévreuse, la prise de l’incendie), ou pour contempler le visage d’une héroïne (Viola Dana) aux gros plans saisissants. Sans génie mais très honorable, passé une première partie moins inspirée, Children of Eve se révèle au final un film tout à fait plaisant.
Les Huit salopards
Quentin Tarantino / 2016
Quelques années après la Guerre de Sécession, alors qu’un blizzard fait rage, huit personnes trouvent refuge dans une auberge au milieu des montagnes. (The Hateful Eight en VO)
Spoilers. Les trois heures semblaient vouloir creuser la veine romanesque et linéaire qui faisait de Django Unchained, malgré ses défauts, un film singulier dans le panthéon Tarantinien. On déchante vite – même si Les Huit salopards, en refusant tant les héros que la vérité de leurs légendes, a l’intelligence de se présenter comme une suite officieuse à Django, à qui il offre à rebours l’amertume d’une introspection morale. Inutile de nier l’indéniable force de conteur de Tarantino, ni cette qualité de facture qui enterre la concurrence : en son centre, quand les différentes lignes du récit s’entrelacent en un cluedo géant, son film est tout bêtement le plus prenant de l’année. C’est alors d’autant plus navrant de voir l’ensemble se complaire dans un alignement stérile de dialogues en cellules closes (pénible premier tiers), ou encore de se perdre dans un long jeu de massacre sans goût ni direction. Le mélange prometteur de deux genres étrangers (le western et le gore) se vautre dans l’auto-caricature, jusqu’à ne plus donner de poids à rien : la perte d’un frère par exemple, et les abîmes d’horreur et de douleur à laquelle elle devrait ouvrir, devient un simple gag sur la route d’un alignement de bons mots. Le film se ratatine fièrement sur son ironie et ses prétentions symboliques, pour se finir chez Guy Ritchie : pour qui pensait passer trois heures avec Tarantino, c’est un peu douloureux.
Les Aventures extraordinaires de Mr West au pays des bolcheviks
Lev Koulechov / 1924
Un citoyen américain, Mr West, visite l’Union soviétique. Tétanisé par l’influence de la propagande américaine, il craint de n’y croiser que des Bolcheviks armés de faucilles et de marteaux… (Neobychainye priklyucheniya mistera Vesta v strane bolshevikov en VO)
Légers spoilers. Reconnaissons au film deux réflexes salvateurs. Le premier est de faire des deux américains (Mr West et son garde du corps) non pas des hommes mauvais, mais des hommes naïfs : la crédulité sans bornes du premier, et les velléités de cowboy du second, font primer l’absurde (voire une certaine tendresse) sur les démonstrations ronflantes de la satire. La seconde bonne surprise tient à la relative discrétion formelle du film, qui évite de faire de l’humour un simple prétexte aux expérimentations de montage. La forme vibre avant tout d’un amour évident pour le genre américain : moquer l’hystérie du garde du corps yankee, c’est surtout s’autoriser à réaliser un western dans les rues de Moscou. Mais le genre ici adulé c’est d’abord le burlesque, auquel Koulechov peine malheureusement à donner vie autrement que par segments courts, isolés, certes très vivaces, mais finalement plus occupés à retrouver la science du genre (comme on le dirait de la recherche d’une juste formule chimique) qu’à réellement narrer. Hormis un dernier tiers qui retrouve les qualité et l’unité d’un geste long, Koulechov opère comme à la VGIK, c’est-à-dire en chercheur. Surprise, alors, de retrouver le versant théorique sinistre du muet soviétique là où on l’attendait le moins : dans la sincère passion américaine d’un premier de la classe.










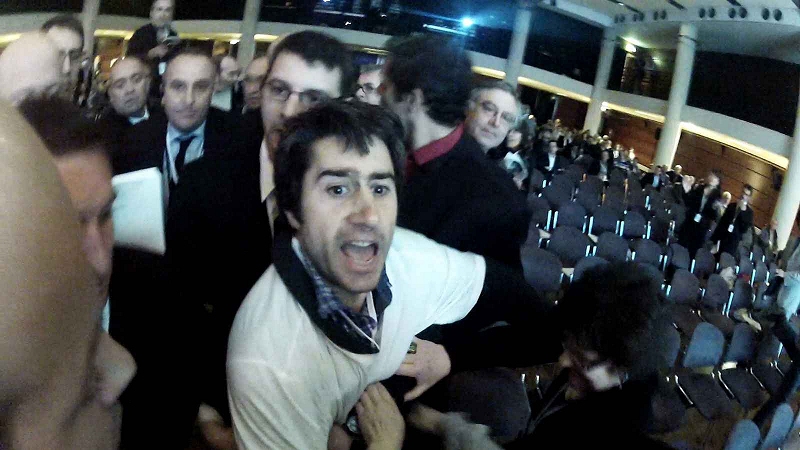
Je n’ai pas vu le puritain Children of Eve mais apparemment, tu n’as pas vu le délirant The mystery of the leaping fish ou le rousseauiste The half-breed: il faut faire attention à ne pas généraliser trop vite sur le cinéma américain circa 1915 qui me semble d’une richesse extraordinaire.
Je me réjouis d’apprendre la sortie prochaine du DVD du Roi des resquilleurs chez René Chateau.
Je ne savais pas que Robert Duvall avait réalisé un nouveau film. Ce que tu en dis m’attriste d’autant que ça a l’air corroboré par la presse. La beauté argentine de Luciana Pedraza était pourtant un des atouts de Assassination tango, film en -eçà du formidable Prédicateur mais quand même honorable dans mon souvenir.
Yo ! Je ne prétends pas avoir une idée très générale du mélo de la période, et je ne me posais effectivement pas la question, n’en ayant jamais vu jusqu’ici sans cet arrière-fond (je ne connaissais pas les films dont tu parles, donc). Après je n’ai pas vu grand chose (ou en tout cas : pas de beaucoup de réals différents), et dans ma tête je l’associe par ailleurs pas forcément seulement à Hollywood : je retrouve aussi pas mal de ça dans le muet danois.
Pour le René Château, je ne pense pas que tu partages mon allergie au cinéma français d’alors : ça pourrait donc te plaire, car il y a du métier et des idées, c’est pas torché du tout.
Au vu de la cata qu’est “Wild Horses”, je suis surpris de découvrir que les anciens films de Duvall sont estimés. Luciana Pedraza, je suis content que tu confirmes (bon sa beauté je laisse chacun juger, mais sur le reste !), car sur le coup je me demandais si je sauvais pas un truc du film juste par pitié…
Une remarque sur Fatima, j’ai aussi eu peur du film didactique sur la première scène. D’autant que j’ai vu ce film sans le vouloir complètement. Finalement il m’a semblé très juste dans sa description, très soignée, où tout semble très justifié (un peu trop peut-être ?). Zita Hanrot est en effet pleine de lumière. J’apprécie la place laissée à l’écrit dans ce film. Étonnamment on retrouve dans les Habitants de Depardon, cela me revient maintenant, un couple mère-fille qui évoque les études de médecine, la spécialisation et le déménagement à suivre, comme si Fatima et sa grande fille avaient été invitées et étaient montées à leur tour dans la caravane du photographe.
Hey, Benjamin ! Je n’ai pas vu le Depardon, malheureusement. Mais pour rebondir sur ta remarque, là est peut-être mon gros regret sur “Fatima” : si j’aime aussi beaucoup le côté “écrit” du film dans ses dialogues simples, élémentaires, calmes, je trouve que Faucon n’arrive pas vraiment à faire quelque chose de ce que Fatima écrit elle-même sur son cahier, à le faire bien dialoguer avec le film. (alors que si j’ai bien compris, le film est inspiré de ces écrits).